Art: le masque et le portrait
l’acteur s’est longtemps écouté lui-même ; c’est qu’il s’écoute au moment où il vous trouble, et que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompez. Diderot, Paradoxe sur le comédien.
LE MASQUE DISSIMULE...

Si à l’origine le masque appartient au domaine religieux, permettant dans les sociétés primitives d’établir un lien entre l’homme et les forces surnaturelles, il devient avec le théâtre antique et surtout romain un objet profane de dissimulation.Rappelons aussi que le masque grec est issu du culte de Dionysos. En effet, selon le mythe, Dionysos se serait incarné dans un fragment de bois tombé du ciel après que Zeus ait foudroyé la couche de Séléné (déesse de la pleine lune). Par la suite, ce fragment de bois fut érigé en colonne, revêtu d’un costume et décoré par les grecs.
Les masques furent d'abord en cuir, puis en bois. Le sculpteur les composait selon les indications du poète. Il y avait quatre sortes de masques :
![]() ceux de la tragédie, y compris les masques des Ombres, des Gorgones et des Furies: ils inspiraient la terreur ;
ceux de la tragédie, y compris les masques des Ombres, des Gorgones et des Furies: ils inspiraient la terreur ;
![]() ceux de la comédie, qui accentuaient le ridicule ;
ceux de la comédie, qui accentuaient le ridicule ;
![]() ceux du drame satyrique, représentant les Satyres, les Faunes, les Cyclopes et autres monstres de la Fable ;
ceux du drame satyrique, représentant les Satyres, les Faunes, les Cyclopes et autres monstres de la Fable ;
![]() enfin ceux des danseurs.
enfin ceux des danseurs.
L'avantage des masques consistait à reproduire fidèlement des types convenus, à donner à la tête un caractère bien déterminé et à rendre plus intelligibles les paroles, en permettant d'y ajuster des cornets qui augmentaient le volume de la voix.
Donc l'acteur est un autre que lui tout en demeurant lui-même derrière le masque grâce à une juste distance.
Le personnage (masque en latin) est lui et un autre. Jouer un rôle c'est être un autre et soi-même.
Jouer introduit ainsi un espace de liberté avec soi-même..
LE PREMIER
Moi, je lui veux beaucoup de jugement ; il me faut dans cet homme un spectateur froid et tranquille ; j'en exige, par conséquent de la pénétration et nulle sensibilité, l'art de tout imiter ou, ce qui revient au même, une égale aptitude à jouer toute sorte de caractères et de rôles.
LE SECOND
Nulle sensibilité !
LE PREMIER
[…] Si le comédien était sensible, de bonne foi lui serait-il permis de jouer deux fois de suite un même rôle avec la même chaleur et le même succès ? Très chaud à la première représentation, il serait épuisé et froid comme un marbre à la troisième.
[…] Mais quoi ? dira-t-on, ces accents si plaintifs, si douloureux, que cette mère arrache du fond de ses entrailles, et dont les miennes sont si violemment secouées, ce n’est pas le sentiment actuel qui les produit, ce n’est pas le désespoir qui les inspire ? Nullement ; et la preuve, c’est qu’ils sont mesurés ; qu’ils font partie d’un système de déclamation ; que plus bas ou plus aigus d’une vingtième partie d’un quart de ton, ils sont faux ; qu’ils sont soumis à une loi d’unité ; qu’ils sont, comme dans l’harmonie, préparés et sauvés : qu’ils ne satisfont à toutes les conditions requises que par une longue étude ; que pour être poussés juste, ils ont été répétés cent fois, et que, malgré ces fréquentes répétitions, on les manque encore ; c’est qu’avant de dire :
Zaïre, vous pleurez !
ou,
Vous y serez, ma fille,
l’acteur s’est longtemps écouté lui-même ; c’est qu’il s’écoute au moment où il vous trouble, et que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire, et ont été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront ; attendez-les à ce mot, à cette syllabe, ni plus tôt ni plus tard. Ce tremblement de la voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation, leçon recordée d’avance, grimace pathétique, singerie sublime dont l’acteur garde le souvenir longtemps après l’avoir étudiée, dont il avait la conscience présente au moment où il l’exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et pour lui, toute liberté de son esprit, et qui ne lui ôte, ainsi que les autres exercices, que la force du corps. Le socque ou le cothurne déposé, sa voix est éteinte, il éprouve une extrême fatigue, il va changer de linge ou se coucher ; mais il ne lui reste ni trouble, ni douleur, ni mélancolie, ni affaissement d’âme. C’est vous qui remportez toutes ces impressions. L’acteur est las, et vous tristes ; c’est qu’il s’est démené sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener. S’il en était autrement, la condition de comédien serait la plus malheureuse des conditions ; mais il n’est pas le personnage, il le joue et le joue si bien que vous le prenez pour tel : l’illusion n’est que pour vous ; il sait bien, lui, qu’il ne l’est pas.
[...] Mais un [...] trait où je vous montrerai un personnage rendu plat et sot par sa sensibilité, et dans un moment suivant sublime par le sang-froid qui succéda à la sensibilité étouffée, le voici :
Un littérateur, dont je tairai le nom, était tombé dans l'extrême indigence. Il avait un frère, théologal et riche. Je demandais à l'indigent pourquoi son frère ne le secourait pas. C'est, me répondit-il, que j'ai de grands torts avec lui. J'obtiens de celui-ci la permission d'aller voir M. le théologal. J'y vais. On m'annonce ; j'entre. Je dis au théologal que je vais lui parler de son frère. Il me prend brusquement par la main, me fait asseoir et m'observe qu'il est d'un homme sensé de connaître celui dont il se charge de plaider la cause ; puis, m'apostrophant avec force : « Connaissez-vous mon frère ? - Je le crois. - Vous le croyez ? Vous savez donc ?... » Et voilà mon théologal qui me débite, avec une rapidité et une véhémence surprenante, une suite d'actions plus atroces, plus révoltantes les unes que les autres. Ma tête s'embarrasse, je me sens accablé ; je perds le courage de défendre un aussi abominable monstre que celui qu'on me dépeignait. Heureusement mon théologal, un peu prolixe dans sa philippique, me laissa le temps de me remettre ; peu à peu l'homme sensible se retira et fit place à l'homme éloquent, car j'oserai dire que je le fus dans l'occasion. « Monsieur, dis-je froidement au théologal, votre frère a fait pis, et je vous loue de me celer le plus criant de ses forfaits. - Je ne cèle rien. - Vous auriez pu ajouter à tout ce que vous m'avez dit, qu'une nuit, comme vous sortiez de chez vous pour aller à matines, il vous avait saisi à la gorge, et que tirant un couteau qu'il tenait caché sous son habit, il avait été sur le point de vous l'enfoncer dans le sein. - Il en est bien capable ; mais si je ne l'en ai pas accusé, c'est que cela n'est pas vrai... » Et moi, me levant subitement, et attachant sur mon théologal un regard ferme et sévère, je m'écriai d'une voix tonnante, avec toute la véhémence et l'emphase de l'indignation : « Et quand cela serait vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas encore donner du pain à votre frère ? » Le théologal, écrasé, terrassé, confondu, reste muet, se promène, revient à moi et m'accorde une pension annuelle pour son frère.
Diderot, Paradoxe sur le Comédien
Il donne à voir le réel par ce travail de dissimulation. C'est là tout le paradoxe de l'art et la leçon des masques.
Le portrait
la question qui se pose à propos du portrait est celle de savoir si celui-ci est une imitation ou s'il a une autre signification.
pour commencer partons de quelquesexemples. Le premier sera celui de Fritz Lang, La femme au portrait.
ANALYSE ET CRITIQUE
En 1944, Fritz Lang vient de réaliser consécutivement trois films essentiellement consacrés à l’effort de guerre anti-nazi, mais desquels transpirent ponctuellement ses récurrentes obsessions psychanalytiques (notamment Ministry of Fear, qui baignait dans l’onirisme). Au même moment, le cinéma américain est marqué par l’émergence d’un « cycle noir », ensemble d’œuvres pour la plupart dues à des cinéastes d’origine européenne (Wilder, Preminger, Siodmak…) qui viennent bousculer les conventions narratives autant qu’elles louvoient avec les contraintes du code de censure Hays. Tournés simultanément par les principales compagnies de production rivales, des films comme Laura, Assurance sur la mort, Phantom Lady ou La Femme au portrait, donc, partagent un certain nombre de thématiques (dualité aliénante, ambiguïté sexuelle, perte d’identité…) qui servent de révélateur à l’angoisse d’une Amérique névrosée par la conjonction du conflit  mondial, de la dépression économique et d’une crise morale majeure. S’il s’agit aux Etats-Unis d’un besoin fort mais relativement contextuel, la psychanalyse avait été chez Fritz Lang dès sa période allemande une source d’inspiration thématique autant que formelle : les rues sombres et les portes, les ombres inquiétantes et les mondes souterrains font depuis longtemps partie de son univers ; et on peut rétrospectivement considérer que la période « psychanalytique » qu’il aborde avecLa Femme au portrait (laquelle durera, parsemée de quelques intermèdes, jusqu’à L’Invraisemblable vérité en 1956) lui sied mieux que ses efforts propagandistes parfois maladroits du début des années 40.
mondial, de la dépression économique et d’une crise morale majeure. S’il s’agit aux Etats-Unis d’un besoin fort mais relativement contextuel, la psychanalyse avait été chez Fritz Lang dès sa période allemande une source d’inspiration thématique autant que formelle : les rues sombres et les portes, les ombres inquiétantes et les mondes souterrains font depuis longtemps partie de son univers ; et on peut rétrospectivement considérer que la période « psychanalytique » qu’il aborde avecLa Femme au portrait (laquelle durera, parsemée de quelques intermèdes, jusqu’à L’Invraisemblable vérité en 1956) lui sied mieux que ses efforts propagandistes parfois maladroits du début des années 40.
 La Femme au portrait est donc le premier opus d’un corpus de quatre films (jusqu’à House by the River) offrant des variations plus ou moins semblables sur les mêmes thèmes, mais il doit surtout être vu comme le recto clair d’une même feuille dont La Rue rouge, tourné l’année suivante avec peu ou prou la même équipe, serait le verso sombre. Dans les deux films, Edward G. Robinson incarne le brave quidam envoûté par la présence sulfureuse de Joan Bennett et qui se retrouve ainsi, malgré lui, entraîné dans une spirale infernale de chantage et de meurtre... Si nous lions les deux films aussi indissociablement, c’est bien parce que leur « dissemblable analogie » vient tout à fait illustrer la dualité inhérente au registre noir, et notamment cette absolue incertitude qui fait que la même histoire peut, presque indifféremment, basculer vers une issue ou son exacte opposée. Pour une raison toute simple, cependant, nous préférerons nettement La Rue rouge : la linéarité tragique du film renvoie en effet nettement mieux à l’idée d’un destin inéluctable (fondamentale dans le film noir) que la construction plus alambiquée de La Femme au portrait, qui repose sur un artifice narratif parfaitement compréhensible d’un point de vue théorique mais bien moins efficace dramatiquement parlant. Par ailleurs, tandis que La Rue rouge s’inscrit a priori dans un cadre réaliste pour offrir un crescendo de tension et de cruauté, La Femme au portrait part formidablement mais s’essouffle assez brutalement à mi-film. Insistons cependant sur le fait que, au-delà des qualités intrinsèques comparées, tout à fait discutables, c’est leur mise en perspective l’un avec l’autre, et plus encore, au sein de la carrière américaine de Fritz Lang, qui fait leur grande richesse : ce diptyque est ainsi plus que recommandable pour quiconque s’intéresse à la filmographie immense du cinéaste, l’une des plus thématiquement inépuisables au monde.
La Femme au portrait est donc le premier opus d’un corpus de quatre films (jusqu’à House by the River) offrant des variations plus ou moins semblables sur les mêmes thèmes, mais il doit surtout être vu comme le recto clair d’une même feuille dont La Rue rouge, tourné l’année suivante avec peu ou prou la même équipe, serait le verso sombre. Dans les deux films, Edward G. Robinson incarne le brave quidam envoûté par la présence sulfureuse de Joan Bennett et qui se retrouve ainsi, malgré lui, entraîné dans une spirale infernale de chantage et de meurtre... Si nous lions les deux films aussi indissociablement, c’est bien parce que leur « dissemblable analogie » vient tout à fait illustrer la dualité inhérente au registre noir, et notamment cette absolue incertitude qui fait que la même histoire peut, presque indifféremment, basculer vers une issue ou son exacte opposée. Pour une raison toute simple, cependant, nous préférerons nettement La Rue rouge : la linéarité tragique du film renvoie en effet nettement mieux à l’idée d’un destin inéluctable (fondamentale dans le film noir) que la construction plus alambiquée de La Femme au portrait, qui repose sur un artifice narratif parfaitement compréhensible d’un point de vue théorique mais bien moins efficace dramatiquement parlant. Par ailleurs, tandis que La Rue rouge s’inscrit a priori dans un cadre réaliste pour offrir un crescendo de tension et de cruauté, La Femme au portrait part formidablement mais s’essouffle assez brutalement à mi-film. Insistons cependant sur le fait que, au-delà des qualités intrinsèques comparées, tout à fait discutables, c’est leur mise en perspective l’un avec l’autre, et plus encore, au sein de la carrière américaine de Fritz Lang, qui fait leur grande richesse : ce diptyque est ainsi plus que recommandable pour quiconque s’intéresse à la filmographie immense du cinéaste, l’une des plus thématiquement inépuisables au monde.

Le Femme au portrait (nous expliquerons plus tard pourquoi nous préférons le titre original de Woman in the Window) nous présente ainsi le professeur Wanley, expert en criminologie, qui découvre un soir à proximité du club où il aime passer ses soirées le nébuleux portrait, dans une vitrine, d’une mystérieuse inconnue. Tandis qu’il contemple ce fascinant visage, la jeune femme ayant servi de modèle lui apparaît, et lui propose de venir passer la soirée chez elle. Malheureusement, un homme surgit et, après un corps à corps, le professeur assassine ce dernier d’un coup de ciseaux. Conjointement avec la jeune femme, il décide alors de se débarrasser du corps. Redoutable d’efficacité, la première heure du film s’attache donc à décrire les événements et leurs conséquences, avec la minutie mais aussi l’ironie dont on sait Fritz Lang capable : la séquence où le professeur se fait arrêter par un policier avec le corps dissimulé à l’arrière de la voiture, ou la façon dont celui-ci ne cesse de gaffer auprès de son ami procureur, sont parfaitement emblématiques de l’habileté diabolique de Fritz Lang dès qu’il s’agit de jouer avec nos nerfs.

[ATTENTION : La partie suivante révèle des éléments importants de l’intrigue]
 Pour autant, déjà, au sein de ce dispositif très linéaire, sont disséminés plusieurs indices qui, pour peu qu’il soit attentif, invitent le spectateur à s’interroger sur la notion même de réflexivité : cela débute, de manière très ironique, par cette conférence dirigée par le professeur Wanley sur « les aspects psychologiques de l’homicide ». Au tableau, le nom de Sigmund Freud, associé à un certain nombre de concepts tournant autour de la « vie mentale » et de l’inconscient… Avant même qu’il y ait crime, le film vient ainsi confronter l’acte du meurtre à sa perception, se délecter déjà de l’opposition entre la théorie et la pratique : ce professeur, qui disserte sur les différences de graviter entre un cas de légitime défense et un meurtre avec préméditation, sera ensuite amené à envisager le second pour s’acquitter du premier. Plus tard, lorsque le professeur s’arrête devant la vitrine pour y contempler le tableau, il est surpris de voir double : dans son esprit se mêlent brièvement le portrait et le reflet, avant même que la belle inconnue ne prenne chair (d’où la pertinence du titre original : Woman in the Window). A partir de là, le film multipliera les effets de miroir, autant pour créer physiquement une multiplication des cadres évoquant la dualité propre à chacun des protagonistes que pour brouiller, d’une certaine manière, les perceptions et plonger le spectateur, en quelque sorte, « de l’autre côté du miroir ». En particulier, il s’en trouve une multitude dans l’appartement de la jeune femme - notamment un derrière son lit… - comme pour rendre inévitable la confrontation du Professeur avec sa propre image, avec sa propre culpabilité. (1) Un plan extrêmement suggestif voit également le P
Pour autant, déjà, au sein de ce dispositif très linéaire, sont disséminés plusieurs indices qui, pour peu qu’il soit attentif, invitent le spectateur à s’interroger sur la notion même de réflexivité : cela débute, de manière très ironique, par cette conférence dirigée par le professeur Wanley sur « les aspects psychologiques de l’homicide ». Au tableau, le nom de Sigmund Freud, associé à un certain nombre de concepts tournant autour de la « vie mentale » et de l’inconscient… Avant même qu’il y ait crime, le film vient ainsi confronter l’acte du meurtre à sa perception, se délecter déjà de l’opposition entre la théorie et la pratique : ce professeur, qui disserte sur les différences de graviter entre un cas de légitime défense et un meurtre avec préméditation, sera ensuite amené à envisager le second pour s’acquitter du premier. Plus tard, lorsque le professeur s’arrête devant la vitrine pour y contempler le tableau, il est surpris de voir double : dans son esprit se mêlent brièvement le portrait et le reflet, avant même que la belle inconnue ne prenne chair (d’où la pertinence du titre original : Woman in the Window). A partir de là, le film multipliera les effets de miroir, autant pour créer physiquement une multiplication des cadres évoquant la dualité propre à chacun des protagonistes que pour brouiller, d’une certaine manière, les perceptions et plonger le spectateur, en quelque sorte, « de l’autre côté du miroir ». En particulier, il s’en trouve une multitude dans l’appartement de la jeune femme - notamment un derrière son lit… - comme pour rendre inévitable la confrontation du Professeur avec sa propre image, avec sa propre culpabilité. (1) Un plan extrêmement suggestif voit également le P rofesseur, accroupi auprès du corps de la victime, jeter un regard vers la jeune femme tandis que les miroirs au mur démultiplient la scène. Et tandis qu’une statuette dénudée d’une grande blancheur vient renforcer l'érotisme trouble de Joan Bennett, la position soumise du Professeur (Dick de son prénom…), autant que la multiplication des symboles phalliques (les ciseaux, les bouteilles de champagne, les arums dressés…), ne font que renforcer le sous-texte sexuel de la scène, entre accomplissement de l’acte et frustration refoulée.
rofesseur, accroupi auprès du corps de la victime, jeter un regard vers la jeune femme tandis que les miroirs au mur démultiplient la scène. Et tandis qu’une statuette dénudée d’une grande blancheur vient renforcer l'érotisme trouble de Joan Bennett, la position soumise du Professeur (Dick de son prénom…), autant que la multiplication des symboles phalliques (les ciseaux, les bouteilles de champagne, les arums dressés…), ne font que renforcer le sous-texte sexuel de la scène, entre accomplissement de l’acte et frustration refoulée.
Cette façon permanente de tendre un miroir vers l’inexprimé, de révéler les profondeurs de l’âme des protagonistes, n’est pas ici gratuite ; alors que le Professeur ne parvient plus à gérer ce sentiment dévorant de culpabilité,  Fritz Lang le sauve, lors d’une séquence aussi narrativement désespérante (par la force des choses, on a depuis trop vu ce genre de facilités scénaristiques pour les accepter aisément, quand bien même comme ici elles seraient en partie justifiées) que visuellement étourdissante : le Professeur se réveille, dans le fauteuil qu’il occupait avant de rencontrer la jeune femme. Toute l’histoire n’était qu’un cauchemar provoqué par le choc inconscient entre un rêve érotique et la culpabilité intérieure que celui-ci avait provoqué : le Professeur avait été vu, dans la deuxième séquence du film, accompagnant son épouse à la gare (2) et ses compagnons, au club, n’avaient ensuite eu de cesse de le soumettre à la tentation. D’ailleurs, le professeur n’avait-il pas déclaré à ses amis qui l’encourageaient à aller assister à un spectacle de strip-tease : « Si une de ces jeunes personnes souhaite venir effectuer son numéro ici même, je serai ravi d’y assister… Mais s’il faut sortir de ce fauteuil… » ? En effet, il n’en sortira pas.
Fritz Lang le sauve, lors d’une séquence aussi narrativement désespérante (par la force des choses, on a depuis trop vu ce genre de facilités scénaristiques pour les accepter aisément, quand bien même comme ici elles seraient en partie justifiées) que visuellement étourdissante : le Professeur se réveille, dans le fauteuil qu’il occupait avant de rencontrer la jeune femme. Toute l’histoire n’était qu’un cauchemar provoqué par le choc inconscient entre un rêve érotique et la culpabilité intérieure que celui-ci avait provoqué : le Professeur avait été vu, dans la deuxième séquence du film, accompagnant son épouse à la gare (2) et ses compagnons, au club, n’avaient ensuite eu de cesse de le soumettre à la tentation. D’ailleurs, le professeur n’avait-il pas déclaré à ses amis qui l’encourageaient à aller assister à un spectacle de strip-tease : « Si une de ces jeunes personnes souhaite venir effectuer son numéro ici même, je serai ravi d’y assister… Mais s’il faut sortir de ce fauteuil… » ? En effet, il n’en sortira pas.
 On a beaucoup reproché à Fritz Lang pour cette fin, en l’accusant notamment d’avoir cédé à la tentation de la happy end pour de simples raisons commerciales (de fait, le film sera un bien plus grand succès public que La Rue rouge, par exemple), d’autant que le roman d’origine, Once Off Guard de J. H. Wallis, s’achevait bien plus tragiquement. Pour comprendre cette décision, il faut cependant avant tout se souvenir que la question de la culpabilité, chez Fritz Lang, n’est jamais prise à la légère, et que le cinéaste ne s’est jamais comporté en démiurge tout-puissant accablant ses protagonistes pour le simple plaisir de le faire. Laissons-le donc s’expliquer : « Ecoutez, cette histoire n’est pas assez grave, pas assez sérieuse pour justifier trois morts. Les spectateurs vont dire : alors quoi ? Robinson tue un homme avec une paire de ciseaux, en état de légitime défense, Duryea est abattu par la police et Robinson se suicide. Si le film se finit comme ça, nous avons un « anti-climax. (…) J’ai pu terminer le film sur un éclat de rire. Je crois que c’est là, avec le soulagement que procurait la découverte qu’il ne s’agissait que d’un rêve, la raison principale du succès de Woman in the Window. » (3) Pour le cinéaste, Wanley n’est qu’un brave père de famille dont la seule faute est de boire un peu plus que de raison et de laisser divaguer son imagination : pourquoi faudrait-il le punir en laissant le destin l’écraser ? Lang sera infiniment plus sévère l’année suivante avec le Chris Cross de La Rue rouge dont la faute, plus universelle, le condamnera à une inexorable déchéance.
On a beaucoup reproché à Fritz Lang pour cette fin, en l’accusant notamment d’avoir cédé à la tentation de la happy end pour de simples raisons commerciales (de fait, le film sera un bien plus grand succès public que La Rue rouge, par exemple), d’autant que le roman d’origine, Once Off Guard de J. H. Wallis, s’achevait bien plus tragiquement. Pour comprendre cette décision, il faut cependant avant tout se souvenir que la question de la culpabilité, chez Fritz Lang, n’est jamais prise à la légère, et que le cinéaste ne s’est jamais comporté en démiurge tout-puissant accablant ses protagonistes pour le simple plaisir de le faire. Laissons-le donc s’expliquer : « Ecoutez, cette histoire n’est pas assez grave, pas assez sérieuse pour justifier trois morts. Les spectateurs vont dire : alors quoi ? Robinson tue un homme avec une paire de ciseaux, en état de légitime défense, Duryea est abattu par la police et Robinson se suicide. Si le film se finit comme ça, nous avons un « anti-climax. (…) J’ai pu terminer le film sur un éclat de rire. Je crois que c’est là, avec le soulagement que procurait la découverte qu’il ne s’agissait que d’un rêve, la raison principale du succès de Woman in the Window. » (3) Pour le cinéaste, Wanley n’est qu’un brave père de famille dont la seule faute est de boire un peu plus que de raison et de laisser divaguer son imagination : pourquoi faudrait-il le punir en laissant le destin l’écraser ? Lang sera infiniment plus sévère l’année suivante avec le Chris Cross de La Rue rouge dont la faute, plus universelle, le condamnera à une inexorable déchéance.

Nous avons plus tôt qualifié l’instant de cette révélation de « visuellement étourdissant » ; il faut en effet rappeler que l’un des talents de Fritz Lang aura toujours été de magnifier les moments clé de son intrigue par des idées de mise en scène fulgurantes. C’est encore le cas ici, et la prodigieuse prouesse qui s’accomplit au moment du réveil du Professeur est aussi admirable pour sa virtuosité technique que pour ce qu’elle suggère selon la grammaire langienne : Wanley, chez lui, après avoir ingurgité des médicaments pour se suicider,  s’assoit dans un fauteuil et sombre progressivement dans l’inconscience. Le téléphone sonne. La caméra s’approche, le cadre en gros plan, puis recule : il est désormais endormi dans le fameux fauteuil de son club, et le maître d’hôtel de celui-ci vient, comme prévu, le réveiller à 10h30. Il n’est pas anodin d’avoir choisi de montrer l’endormissement et le réveil dans le même plan, c’est à dire selon la même temporalité : la rémanence de la culpabilité dans l’inconscient s’imprime de manière bien plus conséquente. La chance de rédemption ainsi offerte au Professeur est également soulignée, tandis que d’autre part Lang achève son film sur ce fameux « rire » évoqué plus tôt, sous la forme d’un joli pied de nez au destin (lequel est souvent représenté chez Fritz Lang par une pendule ou une horloge). Le producteur-scénariste Nunnally Johnson, d’abord rétif à cette idée de rêve, avoua des années plus tard comment ce plan admirable avait contribué à le convaincre : « Le film a donné à Fritz l’occasion de réaliser un des plans les plus ingénieux, sous doute le plus ingénieux que j’aie jamais vu. (…) Ce plan, qui exigeait un changement complet de costume et de décor, fut tourné sans coupure. (…) Robinson portait des vêtements détachables et, pendant les quelques secondes du gros plan, un assistant rampait sous la caméra et les lui retirait, le laissant dans le costume qu’il portait au moment où il s’est endormi ; dans les mêmes secondes, l’équipe avait substitué le décor du club à la chambre où il avait pris le poison. C’est aussi cette ingéniosité qui faisait de Fritz le grand cinéaste qu’il était. » De fait, s’il nous est spontanément venu l’envie de reprocher à Lang cette concession à un artifice narratif aussi apparemment « facile », il faut bien reconnaître au final que si Woman in the Windowconserve une place singulière dans la filmographie du cinéaste, le film le doit presque moins à la qualité de son intrigue (toutes les séquences avec Dan Duryea plombent quelque peu la seconde partie) qu’à cette pirouette marquante qui aura fait couler beaucoup d’encre.
s’assoit dans un fauteuil et sombre progressivement dans l’inconscience. Le téléphone sonne. La caméra s’approche, le cadre en gros plan, puis recule : il est désormais endormi dans le fameux fauteuil de son club, et le maître d’hôtel de celui-ci vient, comme prévu, le réveiller à 10h30. Il n’est pas anodin d’avoir choisi de montrer l’endormissement et le réveil dans le même plan, c’est à dire selon la même temporalité : la rémanence de la culpabilité dans l’inconscient s’imprime de manière bien plus conséquente. La chance de rédemption ainsi offerte au Professeur est également soulignée, tandis que d’autre part Lang achève son film sur ce fameux « rire » évoqué plus tôt, sous la forme d’un joli pied de nez au destin (lequel est souvent représenté chez Fritz Lang par une pendule ou une horloge). Le producteur-scénariste Nunnally Johnson, d’abord rétif à cette idée de rêve, avoua des années plus tard comment ce plan admirable avait contribué à le convaincre : « Le film a donné à Fritz l’occasion de réaliser un des plans les plus ingénieux, sous doute le plus ingénieux que j’aie jamais vu. (…) Ce plan, qui exigeait un changement complet de costume et de décor, fut tourné sans coupure. (…) Robinson portait des vêtements détachables et, pendant les quelques secondes du gros plan, un assistant rampait sous la caméra et les lui retirait, le laissant dans le costume qu’il portait au moment où il s’est endormi ; dans les mêmes secondes, l’équipe avait substitué le décor du club à la chambre où il avait pris le poison. C’est aussi cette ingéniosité qui faisait de Fritz le grand cinéaste qu’il était. » De fait, s’il nous est spontanément venu l’envie de reprocher à Lang cette concession à un artifice narratif aussi apparemment « facile », il faut bien reconnaître au final que si Woman in the Windowconserve une place singulière dans la filmographie du cinéaste, le film le doit presque moins à la qualité de son intrigue (toutes les séquences avec Dan Duryea plombent quelque peu la seconde partie) qu’à cette pirouette marquante qui aura fait couler beaucoup d’encre.

[Fin des révélations]
Nous ne surévaluerons pas ici l’importance de La Femme au portrait dans la filmographie de Fritz Lang : le film en lui même comporte un certain nombre de défauts qu’il serait inutile de taire. Pour autant, et quand bien même cela a déjà été dit, nous ne saurons jamais trop saluer la pertinence d’une édition conjointe du film avec La Rue rouge. Car la vision, si possible dans cet ordre, des deux films ne permet que mieux d’exalter cette manière si exceptionnelle qu’avait Fritz Lang d’imprégner les histoires les plus variées de sa personnalité et de ses obsessions, cette façon si unique de jouer avec les tonalités : du suspense teinté d’onirisme à la satire, puis du réalisme social à la tragédie antique, ce diptyque est un parfait témoignage du formidable talent du cinéaste.
(1) Fritz Lang a d’ailleurs supprimé du montage final, parce qu’il les trouvait redondants, des plans en surimpression de l’épouse et des enfants de Wanley l’implorant : « Non, Richard, tu n’as pas fait ça ! »
(2) Instant que le cinéma américain n’aura de cesse de décrire comme l’ouverture d’une parenthèse de liberté sexuelle adultère, souvenons-nous des premiers instants drolatiques, par exemple, de Sept ans de réflexion.
(3) Extrait d’une interview accordée en 1969 à Charles Higham et Joel Greenberg. Il conforte ainsi des propos tenus vingt ans plus tôt : « Je ne suis pas toujours objectif en ce qui concerne mes films, mais dans ce cas mon choix était conscient. Si j’avais mené l’histoire à sa conclusion logique, un homme aurait été arrêté et exécuté pour avoir commis un meurtre « once off guard. » Et même s’il n’avait pas été condamné pour ce crime, sa vie était ruinée. J’ai rejeté cette fin logique parce qu’elle me paraissait défaitiste : une tragédie pour rien, provoquée par un Destin implacable, une conclusion négative à un problème qui n’est pas universel, une tristesse futile que le public aurait rejeté. Le film a remporté un succès considérable, et je peux me tromper, mais je pense qu’avec une autre fin ce succès aurait été moindre. » (extrait de Happily Ever After, 1947, rappelés par Lotte Eisner)
http://www.dvdclassik.com/critique/la-femme-au-portrait-lang

Représentation d’un modèle, on pourrait croire spontanément que le portrait présente une copie fidèle de ce dernier, une certaine répétition. Cependant la lecture de Le portrait de Dorian Gray devrait nous amener à douter d’une telle définition. En effet le tableau va peu à peu refléter la véritable personnalité du modèle., mais subitement, à la fin, le tableau retrouve son autonomie et se libère de cette fidélité au modèle dont il ne sera plus la copie. D’une part cela implique que l’art est libre à l’égard de toute utilité , utilité morale dans le cas de ce roman, aux apparences morales. Il est même fondamentalement inutile écrira Oscar Wilde. L’art est ainsi plus qu’un savoir-faire. D’autre part, il a sa propre finalité et ne renvoie peut-être qu’à lui-même. Ainsi le portrait n’est-il ni la copie du modèle, ni la copie de l’âme du peintre…et encore moins une œuvre édifiante à vocation morale.
|
|
 Le Portrait de Dorian Gray (Version Intégrale)
Le Portrait de Dorian Gray (Version Intégrale)Partager Enregistrement : Audiocite.net Lu par Joane Livre audio de 8h17min - Fichier Zip de 455 Mo (il contient des Mp3) Exporter: Feuilleton audio (20 Chapitres) Chap 1, Chap 2, Chap 3, Chap 4, Chap 5, Chap 6, Chap 7, Chap 8, Chap 9, Chap 10, Chap 11, Chap 12, Chap 13, Chap 14, Chap 15, Chap 16, Chap 17, Chap 18, Chap 19, Chap 20. 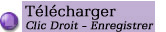 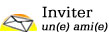 
Cet enregistrement est libre, vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier selon les termes de la Licence Art Libre.  Le Portrait de Dorian Gray(The Picture of Dorian Gray) est un roman d'Oscar Wilde, publié en 1890 (révisé en 1891) et écrit dans le contexte de l'époque victorienne. Le Portrait de Dorian Gray(The Picture of Dorian Gray) est un roman d'Oscar Wilde, publié en 1890 (révisé en 1891) et écrit dans le contexte de l'époque victorienne.Oscar Wilde y inclut des thèmes relevant de l'esthétique tels que l'art, la beauté, la jeunesse, la morale, l'hédonisme, etc. Le roman est fantastique, mais aussi philosophique, et met en lumière la personnalité équivoque du dandy irlandais Oscar Wilde. Histoire Dorian Gray est un jeune homme d'une très grande beauté. Son ami artiste peintre Basil Hallward est obsédé par cette dernière et en tire toute son inspiration. Sa fascination pour le jeune homme le mène à faire son portrait, qui se révèle être la plus belle oeuvre qu'il ait jamais peinte, et qu'il ne souhaite pas exposer : « J'y ai mis trop de moi-même ». Dorian va faire la connaissance de Lord Henry, dit Harry, un ami de Basil. Conscient de la fascination et de la perversion que ce dernier pourrait avoir pour son idéal de beauté, « cette nature simple et belle », Basil demande à Lord Henry de ne pas tenter de le corrompre. Mais Dorian se laisse séduire par les théories sur la jeunesse et le plaisir de ce nouvel ami qui le révèle à lui-même en le flattant : « Un nouvel hédonisme [...] Vous pourriez en être le symbole visible. Avec votre personnalité, il n'y a rien que vous ne puissiez faire ». Va naître dès lors en lui une profonde jalousie à l'égard de son propre portrait peint par Basil Hallward. Il souhaite que le tableau vieillisse à sa place pour que lui, Dorian Gray, garde toujours sa beauté d'adolescent. « Si le tableau pouvait changer tandis que je resterais ce que je suis ! ». Le garçon tombe par la suite amoureux d'une comédienne, Sibyl Vane, et lui promet le mariage. L'amour empêchant Sibyl de bien jouer, Dorian la répudie, ce qui la pousse au suicide. Il remarque alors que le portrait s'est empreint à sa place d'une expression de cruauté et comprend que son voeu a été exaucé. Par peur que quelqu'un ne découvre son terrible secret, il enferme le tableau dans une ancienne salle d'étude et se plonge dans la lecture d'un mystérieux roman que lui offre Lord Henry. Bien des années passent durant lesquelles il accumule les péchés et devient de plus en plus mauvais sous l'influence de Lord Henry et de ce livre empoisonné. Le tableau prend sur lui la laideur de l'âge et de la décadence. Gray finit par révéler son secret à Basil, puis, comme celui-ci l'accuse et le traite de meurtrier, fou de haine, il le tue.Il se debarrasse ensuite du cadavre avec l'aide de Alain Campbell en usant du chantage. Pour oublier sa culpabilité, Dorian se rend dans les bas-fonds de Londres fumer de l'opium.James Vane,le frère de Sibyl Vane, un marin, l'y reconnaît et tente de le tuer. Dorian échappe à la mort grâce à son éternelle jeunesse : en effet, il ne parait que vingt ans alors que les faits se sont déroulés dix-huit ans plus tôt ! Le marin n'est dupe qu'un instant et cherche à retrouver Gray. Il meurt plus tard, accidentellement, tué par des chasseurs dans la demeure d'une amie de Dorian. Dorian, poursuivi par sa mauvaise conscience, décide alors de devenir sage. Après sa première bonne action, il court voir si le portrait n'aurait pas embelli mais la toile porte encore plus qu'avant les traits de la vanité et de l'hypocrisie. Désespéré, Dorian enfonce le couteau qui a tué Basil dans le tableau. Un homme vieux et hideux est retrouvé mort en face du tableau, qui a retrouvé sa beauté première. Après examen des bagues du défunt, on reconnaît en lui Dorian Gray. |


